Tourisme 2.0 : anatomie de la France Airbnb
Étude Institut Terram x Datagora : comment Airbnb redessine la carte du tourisme français, entre digitalisation, économie locale et régulation.

Tourisme 2.0 : anatomie de la France Airbnb
Une étude inédite sur la transformation du tourisme français
En octobre 2025, l’Institut Terram a publié, en collaboration avec Datagora, une étude d’ampleur nationale intitulée « Tourisme 2.0 : anatomie de la France Airbnb », signée par Jérôme Fourquet, Sylvain Manternach et Chloé Tegny.
Pour la première fois, Airbnb a ouvert ses données à un organisme de recherche indépendant, permettant une lecture objective et territoriale de l’impact de la plateforme en France.
Cette enquête révèle un basculement historique : la France est devenue, en à peine dix ans, un pays maillé par le tourisme collaboratif, où les locations saisonnières se comptent désormais dans presque toutes les communes.
De la côte basque aux Vosges, des villages du Lot aux métropoles, le tourisme “Airbnb” a redessiné la géographie des séjours.
1. Un marché devenu incontournable
L’étude souligne la montée en puissance spectaculaire du secteur.
En 2018, la France enregistrait 86 millions de nuitées réservées via les principales plateformes (Airbnb, Booking, Abritel, etc.).
En 2024, ce chiffre atteint 192 millions, soit une multiplication par 2,3 en six ans.
Cette croissance s’explique par la convergence de plusieurs tendances :
- la digitalisation du tourisme et la généralisation de la réservation en ligne ;
- la recherche d’un hébergement plus flexible et authentique, notamment après la pandémie ;
- et l’émergence d’une économie de la proximité, favorisant les séjours courts et les découvertes locales.
Selon les auteurs, cette dynamique positionne la France comme première destination mondiale sur Airbnb, mais surtout comme un laboratoire du tourisme de demain.
2. Une diffusion territoriale sans précédent
En 2013, seules les grandes métropoles, les zones littorales et quelques stations de montagne accueillaient des logements Airbnb.
Dix ans plus tard, huit communes sur dix (soit 28 289 sur 35 000) en comptent au moins une.
Cette extension géographique marque une rupture : le tourisme s’est décentralisé.
Les communes rurales et les villes moyennes, souvent en perte d’attractivité, accueillent désormais des voyageurs venus chercher calme et authenticité.
L’étude parle d’une “démocratisation géographique du tourisme” : Airbnb agit comme un levier d’aménagement du territoire en valorisant des zones autrefois délaissées par le tourisme classique.
Les cartes de l’Institut Terram montrent ainsi une densité particulièrement forte :
- sur la côte basque et en Dordogne, où le tourisme vert et patrimonial s’épanouit ;
- dans la vallée de la Loire, où les séjours culturels dominent ;
- et dans le massif vosgien, qui combine sports d’hiver et tourisme rural.
3. Des logiques locales très contrastées
L’implantation d’Airbnb diffère fortement selon les territoires.
Les zones littorales et montagneuses affichent naturellement une densité de nuitées supérieure, mais de nouveaux bassins émergent, notamment dans les campagnes attractives ou les vallées patrimoniales.
L’étude met aussi en évidence un effet de saisonnalité territoriale : certaines communes enregistrent des pics de fréquentation lors d’événements culturels ou sportifs, comme le Festival de la BD d’Angoulême ou les 24 Heures du Mans.
Airbnb agit ainsi comme un amortisseur territorial, capable d’offrir des hébergements temporaires là où l’offre hôtelière est insuffisante.
Cette flexibilité contribue à soutenir l’économie locale, en permettant à des villes moyennes ou à des zones rurales de profiter ponctuellement d’un afflux touristique, sans investissement structurel massif.
4. Airbnb, plus présent que les hôtels
L’une des conclusions les plus marquantes de l’étude Terram x Datagora est que Airbnb dépasse désormais l’hôtellerie en termes de couverture territoriale.
En 2024, 81 % des communes françaises disposent d’au moins une annonce active sur la plateforme, contre 16 % seulement accueillant un hôtel.
Dans les localités de moins de 500 habitants, l’écart est encore plus saisissant : 69 % de ces communes comptent un logement Airbnb, contre 5 % seulement disposant d’un établissement hôtelier.
Cette mutation illustre la complémentarité entre tourisme collaboratif et hôtellerie traditionnelle.
Les hôtels restent dominants dans les grandes villes et les destinations d’affaires, tandis que les meublés de tourisme occupent un rôle structurant dans la redynamisation des petites communes.
5. Le poids des résidences secondaires
L’étude rappelle que le succès d’Airbnb repose largement sur le parc de résidences secondaires.
La carte du nombre de nuitées réservées recoupe presque parfaitement celle de la part de résidences secondaires.
Certaines régions — comme les Alpes, les Cévennes ou la côte atlantique — concentrent à la fois un fort taux de résidences secondaires et une activité locative saisonnière dense.
Ces logements constituent la base de l’offre touristique française, notamment dans les zones où l’hôtellerie est peu présente.
Pour les propriétaires, cela traduit un modèle économique dual : un usage personnel ponctuel du bien, complété par une exploitation saisonnière permettant de couvrir les charges et d’entretenir le patrimoine.
6. Encadrement et mutation réglementaire
Face à la montée en puissance du secteur, le cadre juridique s’est considérablement renforcé.
- Pour les résidences principales, la location est plafonnée à 120 nuits par an (voire 90 dans certaines villes).
- Pour les résidences secondaires, elle nécessite parfois une autorisation de changement d’usage, assortie d’une obligation de compensation dans les zones tendues.
Les sanctions prévues sont dissuasives : jusqu’à 15 000 € d’amende en cas de dépassement du nombre de nuits autorisées, et 100 000 € pour absence de déclaration.
Sur le plan fiscal, l’étude rappelle que l’abattement forfaitaire des meublés non classés passera de 71 % en 2023 à 30 % en 2025, tandis que celui des meublés classés restera plus avantageux (50 %).
Ce durcissement s’inscrit dans une volonté politique de mieux encadrer les revenus issus de la location saisonnière, tout en favorisant la transparence.
7. Qui sont les “Airbnbnistes” ?
Le profil des utilisateurs français révèle un tourisme diversifié mais jeune.
Selon les chiffres de l’Ifop (décembre 2024), cinq Français sur dix ont déjà séjourné dans un logement Airbnb, et trois sur dix le font au moins une fois par an.
Le portrait-type est celui d’un voyageur :
- actif (74 %),
- plutôt masculin (53 %),
- âgé de moins de 35 ans (39 %),
- et diplômé du supérieur (44 %).
La durée moyenne d’un séjour est de cinq jours, et la majorité des séjours se fait en couple (48 %), en famille (30 %) ou entre amis (14 %).
Ce profil traduit une recherche de flexibilité, mais aussi une volonté de vivre une expérience locale, hors des standards hôteliers.
8. Un moteur économique territorial
Au-delà des chiffres, l’étude met en lumière le rôle économique croissant de la location saisonnière.
En permettant à des milliers de particuliers de générer des revenus complémentaires, Airbnb contribue à redynamiser les économies locales.
Le revenu médian des hôtes français s’élève à 3 800 € brut par an, un apport souvent réinvesti dans l’entretien du logement ou la consommation locale.
Dans certaines communes rurales, cette activité soutient le maintien des commerces de proximité et la valorisation du patrimoine.
Les auteurs parlent d’un “effet de ruissellement territorial”, dans lequel la location saisonnière devient un vecteur indirect de développement économique, notamment dans les zones touristiques secondaires.
9. Le nouveau visage du tourisme français
L’étude “Tourisme 2.0” décrit une France désormais hybride, où les frontières entre hébergement professionnel et particulier s’estompent.
Cette hybridation redéfinit la chaîne de valeur du tourisme : le voyageur recherche moins un service hôtelier qu’une expérience ancrée dans un territoire.
Pour les collectivités, cette transformation impose de nouveaux équilibres : préserver l’accès au logement tout en maintenant l’attractivité touristique.
Certaines villes ont déjà amorcé des politiques de régulation, tandis que d’autres misent sur la cohabitation encadrée entre résidents permanents et locations de courte durée.
10. En conclusion : vers un tourisme durable et distribué
L’analyse de l’Institut Terram confirme que le tourisme français vit une mutation structurelle.
Les plateformes numériques ne se substituent pas à l’hôtellerie traditionnelle : elles complètent une offre devenue plus diverse, plus flexible et plus territorialisée.
Le défi des prochaines années réside dans la régulation équilibrée du secteur et dans la valorisation durable du patrimoine immobilier français.
La montée des contraintes fiscales et administratives pourrait favoriser une professionnalisation croissante des acteurs, notamment via des structures de gestion locales ou para-hôtelières.
C’est dans ce contexte qu’interviennent des opérateurs comme Hostcare, spécialisés dans la gestion para-hôtelière.
Ces acteurs accompagnent les propriétaires dans la mise en conformité réglementaire, la valorisation de leur bien et l’optimisation des revenus, tout en contribuant à l’équilibre entre performance économique et ancrage local.
Sources :
Institut Terram x Datagora, Tourisme 2.0 : anatomie de la France Airbnb, octobre 2025
Eurostat, Insee, Ifop (décembre 2024)
Ministère de la Transition écologique, service-public.gouv
#Airbnb #Tourisme #ÉconomieLocale #Locationsaisonnière #France #InstitutTerram #Datagora #Hostcare
Articles similaires
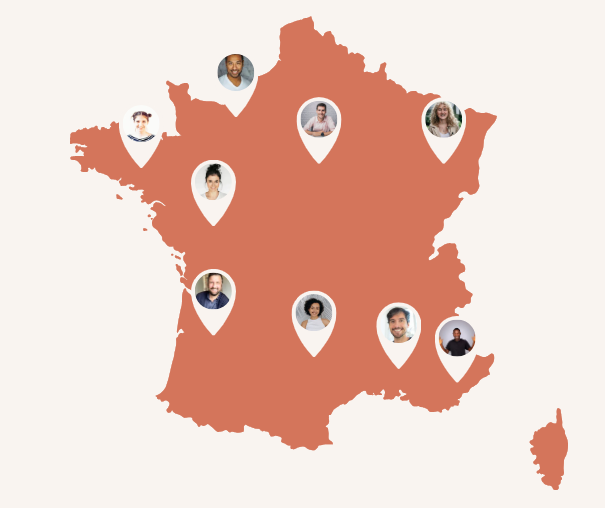
Nos concierges
Découvrez notre réseau de concierges professionnels

Conciergerie sans carte G : quels sont les risques réels en 2026 ?
Découvrez les risques juridiques et financiers d'une conciergerie sans carte G en 2026. Sanctions, contrôles DGCCRF et comment sécuriser votre activité avec le réseau Hostcare.

Numéro d'enregistrement Airbnb : l'obligation de mai 2026 pour les résidences secondaires
Loi Le Meur : le numéro d'enregistrement devient obligatoire pour les résidences secondaires en mai 2026. Découvrez les démarches et les sanctions prévues.
